Des idées pour Noël
A court d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Ou envie de renouveler vos propres lectures ?
Dans ce numéro spécial, je vous présente 6 livres coups de cœur liés aux questions écologiques (+ 3 idées de romans et 2 idées de BD en fin de numéro).
L’occasion aussi de chroniquer ici d’excellents livres de ces dernières années que je n’avais pas encore eu l’occasion d’évoquer dans cette newsletter.
// Lectures faciles //
Champs de bataille - L'Histoire enfouie du remembrement
C’est « la » BD de cette fin d’année sur les sujets écolo (avec, aussi, celle de Philippe Bihouix, “Ressources” – pas encore lue). Très instructive, passionnante, c’est une nouvelle réussite signée Inès Leraud (journaliste) et Pierre Van Hove (dessinateur), déjà auteurs en 2019 de la remarquable BD-enquête « Algues vertes, l'histoire interdite ».
Comme il y a cinq ans, Inès Leraud a réalisé une enquête très documentée, qui se lit comme un polar. On y découvre (ou redécouvre) les origines allemandes et vichystes de la modernisation agricole française, la façon dont le remembrement s’est imposé de force, avec une violence administrative qui a laissé des traces durables – l’enquête témoigne de l’impact émotionnel qui reste vivace chez les protagonistes encore aujourd’hui, et du clivage engendré dans certains villages durant des décennies entières.
Inès Leraud s’appuie sur le travail d’un doctorant en histoire, Léandre Mandard, fils de paysans, et de différentes archives qui racontent les aberrations d’une politique pensée par des ingénieurs dans des bureaux, loin des réalités du terrain dans bien des cas.
« Cette politique décisive pour le déploiement de l’agriculture intensive a jusqu’ici été peu documentée. Aucun livre de sciences humaines n’a été consacré aux perdants du remembrement ».
Ces archives révèlent notamment que les ingénieurs fonctionnaires du génie rural percevaient une commission proportionnelle aux travaux de remembrement (en 1978 par exemple, 100 000 francs de suppléments à se partager entre une centaine d’agents).
L’enquête ressort des déclarations passées (comme celle d’Edgard Pisani, ministre de l’agriculture sous De Gaulle, dans un livre de 2014 : « je n’aurais jamais imaginé que cette politique irait si loin. J’en suis responsable et me sens un peu coupable »), certaines choses intéressantes à savoir (l’agronome René Dumont, avant de devenir une figure de l’écologie politique, était un grand défenseur du productivisme et du remembrement, qui a viré de bord sur le tard à 70 ans), des témoignages inédits (comme cet ex-dirigeant de la FNSEA qui regrette aujourd’hui son engagement pro-remembrement).
Mais au-delà de ces anecdotes, on comprend que « le remembrement va bien au-delà du réaménagement de parcelles : c’est ce qui a amené la disparition de toute une société rurale qui s’auto-organisait sur ses territoires ».
En réalité, pour Inès Leraud, « le remembrement, comme les algues vertes, c’est d’abord une porte d’entrée. Les algues vertes étaient une porte d’entrée vers le système agro-industriel. Le remembrement est un jalon pour saisir la fin d’une civilisation, celle de l’ouest bocager. » (entretien au média d’investigation breton Splann).
A l’heure où de plus en plus de discours soutiennent la plantation de haies, la journaliste met en garde : « Défendre les haies dans un monde où la paysannerie a disparu, c’est presque prendre le problème à l’envers. (...) Si on veut vraiment protéger les haies et les arbres, il faut encourager un modèle agricole auquel elles sont liées, comme l’élevage extensif, l’agriculture à petite échelle, l’installation de nouveaux agriculteurs sur des fermes moins endettées et plus diversifiées ».
« Champs de bataille - L'Histoire enfouie du remembrement » (La Revue Dessinée / Éditions Delcourt, novembre 2024, 23,75 €).
***
Vivent les corneilles
C’est la pépite inattendue de l’année. Une lecture qui ne me disait rien de spécial, mais dans laquelle je suis entré avec curiosité, attiré par plusieurs échos élogieux. Bien loin d’explications rébarbatives sur les corneilles, on y découvre le récit d’une aventure, d’une enquête, celle menée par le chercheur Frédéric Jiguet, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, que la mairie de Paris a chargé d’une mission, en 2015 : mieux connaître ces oiseaux mal-aimés pour voir si une meilleure cohabitation avec les humains ne serait pas possible…
Frédéric Jiguet nous prend par la main et nous raconte, sans chichis dans le style, comme il le raconterait à un ami, ses expérimentations, ses découvertes, ses surprises, et révèle au passage quelques absurdités. On se prend vite au jeu. Cette immersion, passionnante et instructive, dans la démarche scientifique de cet ornithologue, fait de ce livre court (130 pages, séquencé en chapitres de 3 à 6 pages sans temps mort) une lecture enthousiasmante, originale, drôle par moments, et à la portée de tous – bref, qui fait du bien dans le paysage de l’édition sur les sujets écolo. On ressort conquis et avec l’envie de le prêter ou de l’offrir. D’autant qu’au-delà de son sujet d’études, « Vive les corneilles » est aussi un formidable outil pédagogique sur ce qu’est la démarche scientifique.
« Vivent les corneilles: Plaidoyer pour une cohabitation responsable » (Actes Sud, janvier 2024, 21 €)
// Lecture intermédiaire //
Silence dans les champs
Une enquête édifiante et passionnante, d’utilité publique, dont vous avez certainement déjà entendu parler mais qui vaut la lecture entière, au-delà des extraits parus dans la presse et des interviews de l’auteur. En s’appuyant sur de nombreux témoignages, collectés durant sept ans, Nicolas Legendre révèle et décrypte les coulisses du système agricole et agro-industriel en Bretagne (qui fait vivre près de 20% des actifs bretons, en incluant l’activité induite), ses baronnies rurales, ses méthodes proto-mafieuses, l’omerta qui pèse sur les agriculteurs, les pressions sournoises, ainsi que le rôle joué par « l’ordre social breton », dont une culture du silence et une tolérance à diverses formes de violence.
Extraits de témoignages cités dans le livre :
« Il y a une agressivité que les urbains ne soupçonnent pas. Pas sûr que les écolos des villes se rendent compte de ce que nous, écolos des champs, on vit dans les campagnes ».
« La règle tacite dans les coopératives, c'est : "On ne quitte pas la famille". Celui qui s'écarte rompt la solidarité. Il peut alors être mis au ban ».
« Pour empêcher que tu fasses un pas de côté, ils utilisent l'humiliation et les calomnies, ils montent les gens contre toi. Ca peut être des menaces, des choses familiales, des contrôles. Ils chassent en meute ».
« Le système s'appuie sur une masse d'agriculteurs qu'il fait vivre en état de dépendance, dont certains sont d'une fidélité totale. Ces gens peuvent se sentir menacés quand on critique le système, parce que toucher au système, c'est toucher à eux ».
« La vraie question concerne l'écosystème qui vit grâce au modèle actuel : les dizaines de milliers d'emplois dans le machinisme, le marketing, les chaînes de distribution en circuit long, et tout le système bancaire breton...Comment on passe de ça à autre chose sans tout péter ? Il y a une telle imbrication. »
« Combien de fois, lors d'entretiens avec des élus, syndicalistes ou entrepreneurs, ai-je tressailli alors que mon interlocuteur, adepte des éléments de langages policés en public, se montrait, hors micro, aussi virulent vis à vis du modèle dominant qu'un activiste de Greenpeace ! ».
L’éclairage apporté par Nicolas Legendre a l’intérêt d’aller plus en profondeur que ce qu’on entend souvent, en dénouant les nœuds complexes d’un système fondé sur une imbrication d’acteurs : on comprend mieux le fonctionnement des grandes coopératives, les liens tissés entre agriculteurs, industriels, élus locaux, le rôle majeur des banques qui favorisent une « agriculture de flux » (c’est à dire très dépendante en transformation, investissements, achats divers) plutôt qu’une « agriculture de stock » (s’appuyant sur la richesse stockée dans les sols), les façons de contourner la réglementation pour agrandir ses exploitations (« c'est extrêmement simple. Certains de ceux qui arrivent à s'agrandir sont des professionnels de la captation de terre, avec beaucoup d'ingénierie juridique à disposition. C'est un jeu de dupes. La Safer est un nain par rapport à ce rouleau compresseur »)…
Il montre aussi comment la plupart des acteurs de ce système sont coincés dans leur situation et combien il serait naïf de croire qu'un changement pourrait ne reposer que sur leur volonté individuelle.
Le prix Albert Londres l’a récompensé l’an dernier en « applaudissant ce travail d'enquête au long cours sur un sujet essentiel, vital, qui concerne chacun d'entre nous. (…) Un travail difficile, brillant, documenté qui révèle une atmosphère sournoise de féodalité, et décortique les méthodes de ce que l'on pourrait aussi appeler la “Breizh mafia” ».
Puisqu’aucune transition écologique sérieuse (ni adaptation au changement climatique) ne sera possible sans transformation de l’agriculture, on peut considérer qu’il s’agit d’un « must-read » sur les questions écologiques parmi les publications de ces dernières années.
« Silence dans les champs » (en poche chez HarperCollins, septembre 2024, 8,30 €)
// Lectures plus exigeantes //
Peindre au corps à corps - Les fleurs et Georgia O'Keeffe
Un livre très court mais dense de l'historienne de l'art Estelle Zhong Mengual. Un condensé d’intelligence qu’on déguste en prenant conscience de sa chance. L’autrice se penche sur les peintures florales de l’artiste américaine Georgia O’Keeffe, en s’attardant d’abord, dans une introduction passionnante, sur la perception de ses tableaux par la critique.
Pour citer Libération qui présentait l’ouvrage à sa sortie, « tout au long de sa vie, Georgia O’Keeffe a démenti avec vigueur l’interprétation obsessionnellement érotique que la critique livrait de ses fleurs ». Voilà tout le sujet de départ : les fleurs peintes par O’Keeffe n’ont cessé d’être interprétées, encore jusqu’à aujourd’hui, comme des symboles de sexes humains.
Puisque ces fleurs ne sont pas regardées pour ce qu’elles sont, mais pour ce que beaucoup projettent sur elles, Estelle Zhong Mengual fait de l’interprétation des fleurs d’O’Keeffe un symptôme de la « crise de sensibilité au vivant ». Ce faisant, elle redonne le pouvoir aux fleurs - et à l’artiste.
« Ce livre est l’histoire d'une alliance entre des fleurs et une femme qui, ensemble, par la force de la peinture, s’extraient de l’inoffensivité à laquelle elles avaient été assignées. » (4e de couverture)
Apprendre à voir les fleurs différemment, ou plutôt « à voir les fleurs, vraiment » : voilà le projet de ce livre, qui y parvient brillamment, en l’espace de 90 pages seulement. Estelle Zhong Mengual montre en quoi O’Keeffe peint les fleurs depuis le point de vue des pollinisateurs, en quoi cela change tout, pourquoi c’est important.
Elle relie art et écologie, mêle analyses naturalistes et philosophiques, passe par la photographie. C’est par moments exigeant mais c’est un petit bijou - un joli cadeau à (s’)offrir, d’autant que l’édition papier, en petit format, est élégante.
« Peindre au corps à corps - Les fleurs et Georgia O'Keeffe » (Actes Sud, septembre 2022, 20 €)
***
Pour terminer ce numéro, voici deux suggestions d’essais qui décalent le regard vis-à-vis du thème à la mode dans le milieu de l’écologie depuis plusieurs années maintenant, l’attention au vivant, dont le succès (qui est une bonne chose en soi !) semble parfois être quasiment devenu hégémonique et pour lequel la production littéraire est désormais abondante depuis son éclosion au tournant des années 2020 (avec du très bon - cf les exemples cités ci-dessus - et du plus redondant).
Au-delà des livres et de ce seul sujet, on ne compte plus les conférences sur les sujets écolo où l’on entend les mêmes questions et les mêmes réponses, par manque de diversité des invités et de circulation des idées.
Voilà donc de quoi regarder les choses sous d’autres prismes pour enrichir les points de vue.
***
Le soin des choses – politiques de la maintenance
A toi qui cherches une lecture originale, qui sort du lot, des idées qui changent de ce qu’on entend déjà partout sur les sujets écolo – voilà ce qu’il te faut. Un livre de sciences humaines remarquable, salué à sa sortie il y a deux ans (et lauréat du prix du livre d'architecture 2023), et qu’il serait imprudent de chercher à résumer ici tant il est riche.
On pourrait dire, pour simplifier, que c’est le pendant de la pensée du philosophe Baptiste Morizot, cette fois-ci non pas sur le vivant mais sur…les choses matérielles. Et avec une approche pluridisciplinaire, qui convoque des travaux très variés en sciences sociales et humaines pour illustrer « la portée politique des activités de maintenance » - un angle étonnant de prime abord mais dont on perçoit dès l’introduction et le premier chapitre l’intérêt intellectuel et l’importance de s’y pencher.
L’originalité du propos se mesure dès le début lorsque les auteurs (Jérôme Denis, professeur de sociologie à Mines Paris-PSL, et David Pointille, directeur de recherche au CNRS) expliquent en quoi la focalisation sur l’acte de réparation pose problème – une réflexion atypique, à contre-courant des récits dominants de l’écologie, et effectivement convaincante. Je n’en dis pas plus ici pour ne rien divulgâcher.
Les auteurs défendent ensuite une « diplomatie des choses vivantes » (car les choses matérielles, loin d’être immuables, « vivent » elles aussi à leur manière), et appellent à « placer sur la carte des préoccupations politiques un problème qui n’a que très peu droit de cité dans les débats contemporains qualifiés d’écologiques : celui des rapports qu’entretiennent les humains avec la multitude des choses grâce auxquelles ils habitent le monde. »
Il s’agit de « faire entrer la « masse manquante » des objets ordinaires (mais aussi des grandes infrastructures et des machines les plus complexes) en écologie. »
« Pour inventer des usages qui fassent sens sur le plan environnemental, il faut pouvoir se défaire des évidences qui prêtent à la plupart des objets des qualités de stabilité, de solidité et de pérennité sans presque jamais les mettre à l’épreuve. Il faut inventer une diplomatie qui fasse de la fragilité matérielle un point de départ ».
Beau et vaste programme, qu’ils prennent le temps d’expliciter. Heureusement, le propos ne se limite pas à des considérations abstraites – bien au contraire. L’essai fourmille d’exemples inattendus dont partent les auteurs pour en tirer des réflexions. Que veut dire maintenir la Joconde ? Maintenir la signalétique du métro parisien ? Maintenir le village d’Oradour-sur-Glane ? Maintenir une sonde spatiale dédiée à l’étude de Saturne ? Maintenir le corps de Lénine (exposé à Moscou depuis sa mort et réembaumé tous les 18 mois) ? Et en quoi l’étude de ces actes de maintenance, dans toute leur variété, est-elle riche en enseignements ?
Voilà le type d’interrogations que l’on rencontre tout au long de cette véritable odyssée, fine et érudite, construite en sept chapitres. Ce n’est pas un livre grand public, mais cela reste de la vulgarisation de travaux de sciences sociales, accessible à tous les esprits curieux prêts à faire l’effort de cheminer intellectuellement tout au long de ces 350 pages. L’un de mes essais coups de cœur de ces dernières années liés aux questions écologiques.
« Le soin des choses - Politiques de la maintenance » (La Découverte, octobre 2022, 23 €)
***
La Terre habitable – ou l’épopée de la zone critique
« Ce livre propose une lecture décalée par rapport aux discours géologiques, climatiques et écologiques ambiants. Il procède du nécessaire atterrissage que les acteurs de l’écologie invoquent de plus en plus, de ce retour à la Terre.
Dans ce livre, j’ai voulu raconter comme une nouvelle génération de scientifiques, issus de domaines aussi variés que la physique et la sociologie, travaillent conjointement à ce retour à la Terre – non pas la Terre-globe, mais celle que je décris de ma fenêtre ».
Voilà comment le chercheur Jérôme Gaillardet, géochimiste médaillé d’argent du CNRS, présente sa démarche dans l’introduction de cet essai paru l’an dernier. L’auteur fait « varier la focale » : il ne se concentre pas « sur les vivants, mais sur le tout qui les associe aux non-vivants ». Sa promesse : « faire parler l’argile, le calcaire, autant que la bactérie et le chêne », et « soulever le voile de l’entrelacement de l’animé et de l’inanimé, du vivant et non-vivant, des choses et des êtres ».
Le tour de force de l’auteur est de rendre ici passionnant ce qui peut sembler aride ou peu accessible à tout un chacun - la géologie, la géochimie, … - et d’entremêler découvertes de sciences dites « dures », sciences humaines, poésie, parfois même philosophie.
Il fait notamment croiser géologie et écologie, décloisonne les approches, et jette plusieurs pavés dans la mare (par exemple : “à sa fondation, l’écologie scientifique portait la promesse de la synthèse entre l’animé et l’inanimé. Une promesse qu’elle n’a pas tenue, se restreignant de plus en plus à l’étude des vivants”). C’est original et réussi.
“La géologie et l’écologie sont apparues respectivement aux XIXe et XXe siècles et n’ont cessé de se séparer. La géologie s’est modernisée en sciences de la Terre ou géosciences, et rapprochée de la physique et de la chimie ; l’écologie s’est de plus en plus intéressée aux relations entre vivants, au détriment des relations entre les vivants et leur « milieu ». (…) Les révolutions scientifiques du XXe siècle ont paradoxalement accentué la divergence entre sciences de la Vie et sciences de la Terre.”
Cet « ouvrage aussi savant que poétique est l’un des livres les plus inspirants qui aient été écrits récemment sur cette entité encore inconnue qui nous préoccupe de plus en plus : la Terre », écrivait Libération à sa sortie, l’an dernier.
L’essai prend encore une autre dimension dans ses deux derniers chapitres, où il ne mâche pas ses mots contre certaines logiques et états d’esprits d’une partie de la communauté scientifique. Plus positivement, il déroule un véritable projet pour celle-ci, et fait preuve d’une hauteur de vue précieuse sur les sciences de la Terre.
Ces quelques lignes étant bien insuffisantes pour rendre compte de l’intérêt de ce livre, j’en ai sélectionné des extraits intéressants, à retrouver sur ce lien (ouvrez-le, ça vaut le coup !).
« La Terre habitable - ou l'épopée de la zone critique » (La Découverte, octobre 2023, 22 €)
Autres suggestions
Un essai
Dans la catégorie “lecture plus exigeante”, un nouvel ouvrage que je n’ai pas encore lu mais qui suscite beaucoup d’éloges : « Attachements : Enquête sur nos liens au-delà de l'humain », de Charles Stépanoff (déjà auteur de « L'animal et la mort » qui était passionnant, d’une grande érudition et rare finesse sur le sujet de la chasse).
L’historien Jérémie Foa, à qui on peut faire confiance au vu de la qualité et l’originalité de ses livres, en parle comme « l’un des plus grands livres d’anthropologie de la décennie », « un livre magistral ».
***
Trois suggestions de romans abordant les questions écologiques
-Dors ton sommeil de brute, de Carole Martinez : un beau roman de la dernière rentrée littéraire, très bien écrit, un temps cité parmi les favoris du Goncourt. A la fois thriller et fable écologique, l’histoire est originale, dans une atmosphère mystérieuse. Cette fiction poétique et sensible relève quasiment du conte fantastique et tient bien en haleine, malgré quelques longueurs en deuxième partie. Au cœur du roman, le thème du sommeil, qui côtoie notamment celui de l’amour maternel…
-Le Déluge, de l’Américain Stephen Markley, traduit par Charles Recoursé : autre roman de la dernière rentrée, mais très différent. Aucun onirisme ni surnaturel ici. L’auteur nous fait vivre de l’intérieur, sans nous ménager (lecture parfois éprouvante !), les effets du dérèglement climatique sur la société et la politique américaine à travers les yeux d’une petite dizaine de personnages, que l’on suit de 2013 à 2040.
Tout est XXL dans ce roman : 1000 pages, que l’auteur a mis dix ans à finaliser, des scènes stupéfiantes d’un réalisme impressionnant, un tableau d’ensemble sur le futur proche qui marque les esprits. Malgré une mise en route qui prend du temps, ce roman démontre brillamment la force de la fiction pour se projeter vers ce qui pourrait nous arriver. Elu meilleur roman étranger de l’année par la magazine Lire.
Pour en savoir plus, lire notre compte-rendu sur troisdegres.net et « 5 choses que nous retenons du Déluge », tous deux sans spoilers.
-Humus, de Gaspard Koenig : si vous l’aviez raté l’an dernier. C’est encore un autre genre : ni onirique, ni réaliste, il est surtout décapant et satirique, avec un humour rare parmi les « romans écologiques » - tout en réussissant par ailleurs à être instructif et très documenté sur son grand sujet, les…vers de terre. Ses personnages « humains », assez caricaturaux, laissent une impression mitigée voire un arrière-goût de sexisme, mais l’ensemble reste très plaisant à lire, bien écrit, et forme un tout original parmi les romans abordant l’écologie. Un ovni arrivé à la surprise générale en finale du Goncourt l’an dernier.
***
Enfin si besoin, deux autres suggestions de BD en lien avec les questions écologiques, deux valeurs sûres des années précédentes qui font globalement l’unanimité, que beaucoup d’entre vous connaissent déjà : les superbes « La dernière reine », de Jean-Marc Rochette, et « La Recomposition des mondes » d’Alessandro Pignocchi.
***
C’était un « hors-série » de Nourritures terrestres pour cette fin d’année. Vous pouvez me lire désormais dans la newsletter de Trois Degrés (le 4e numéro vient de paraître). Bonnes fêtes de fin d’année ! Clément.

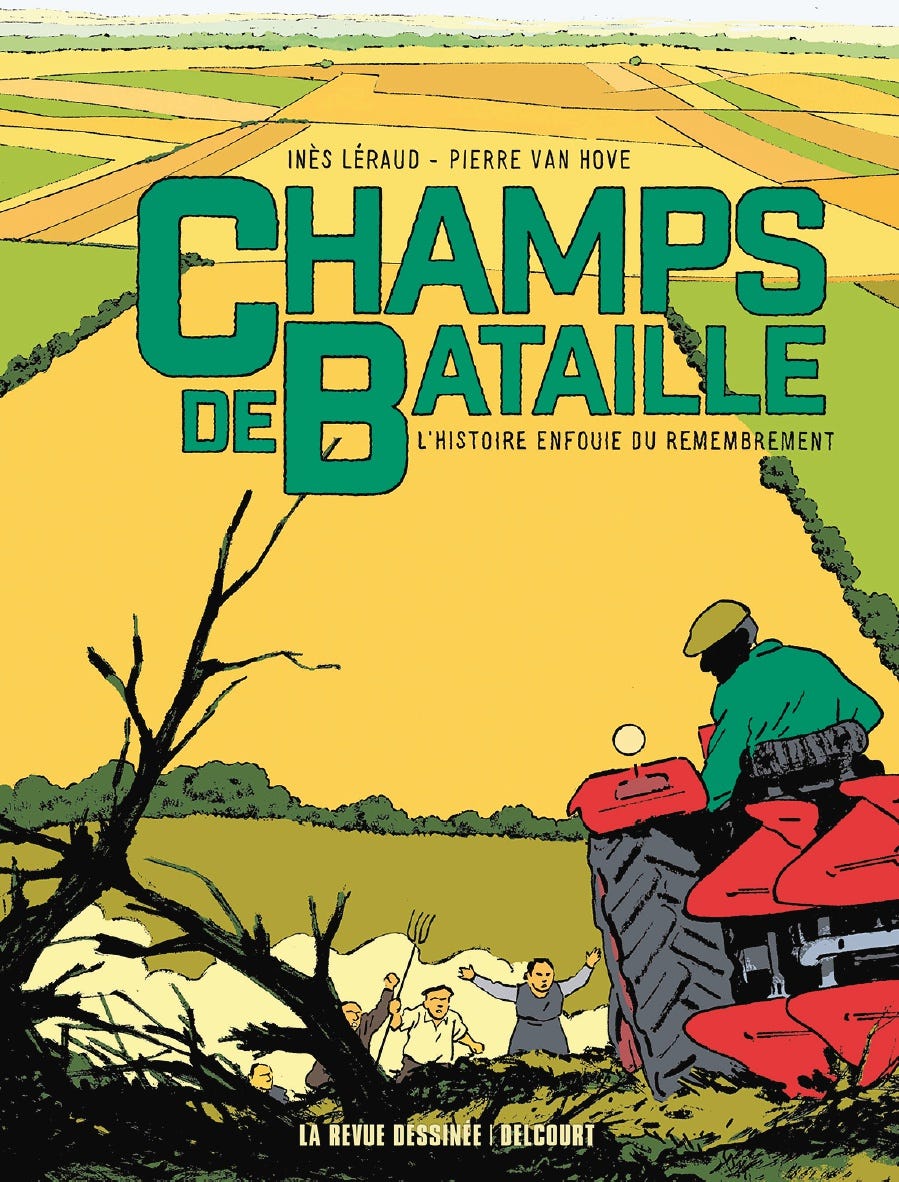
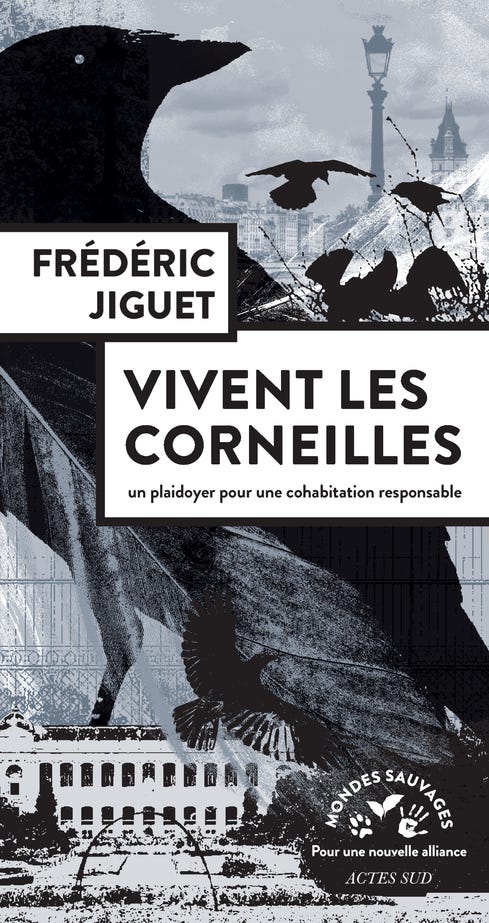
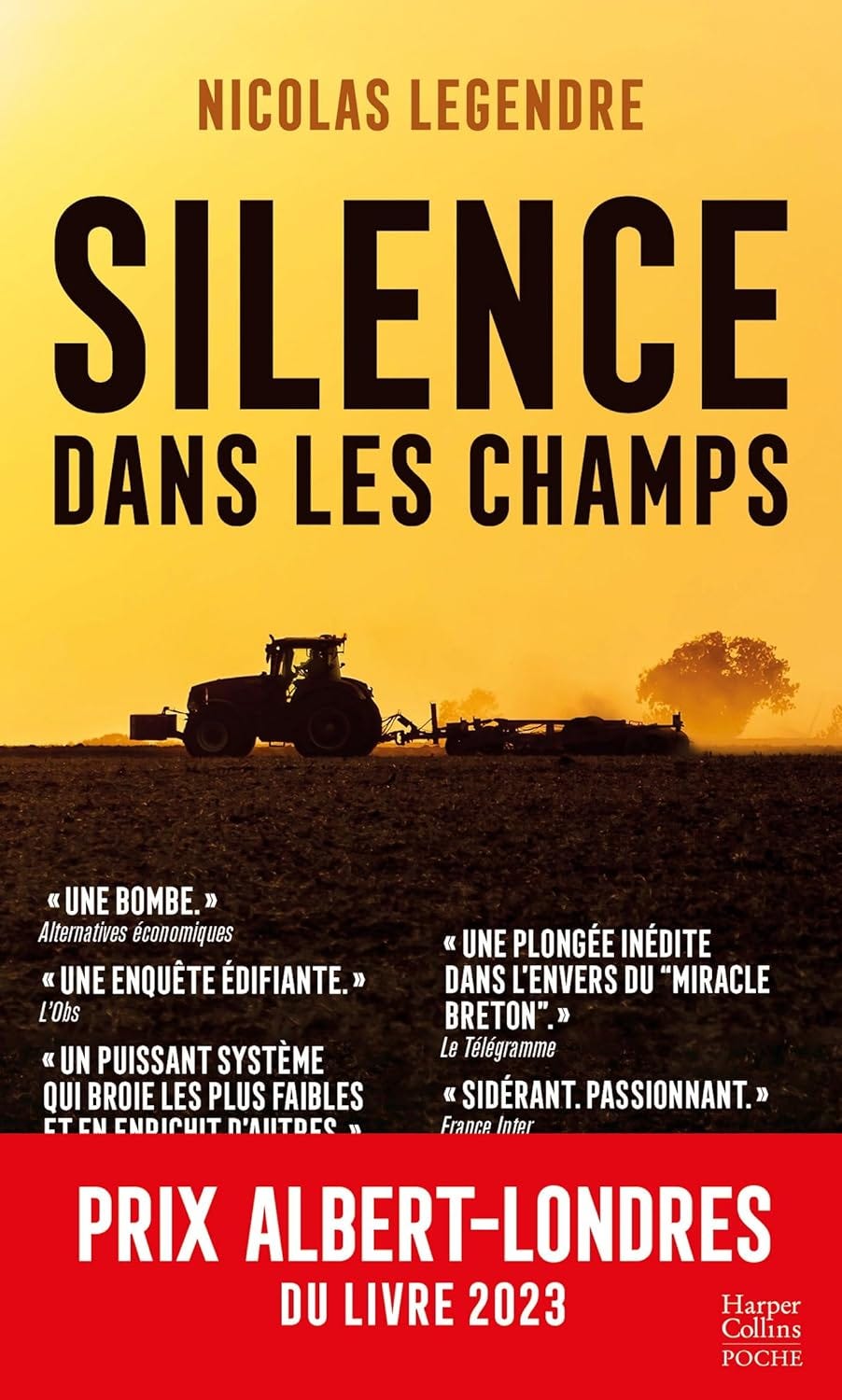
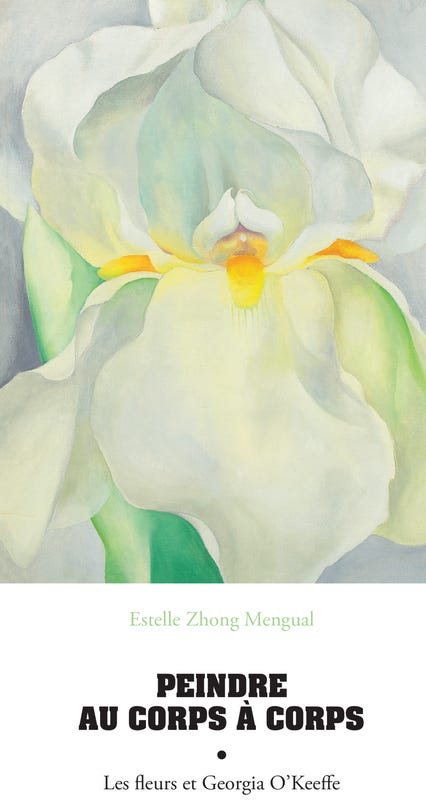
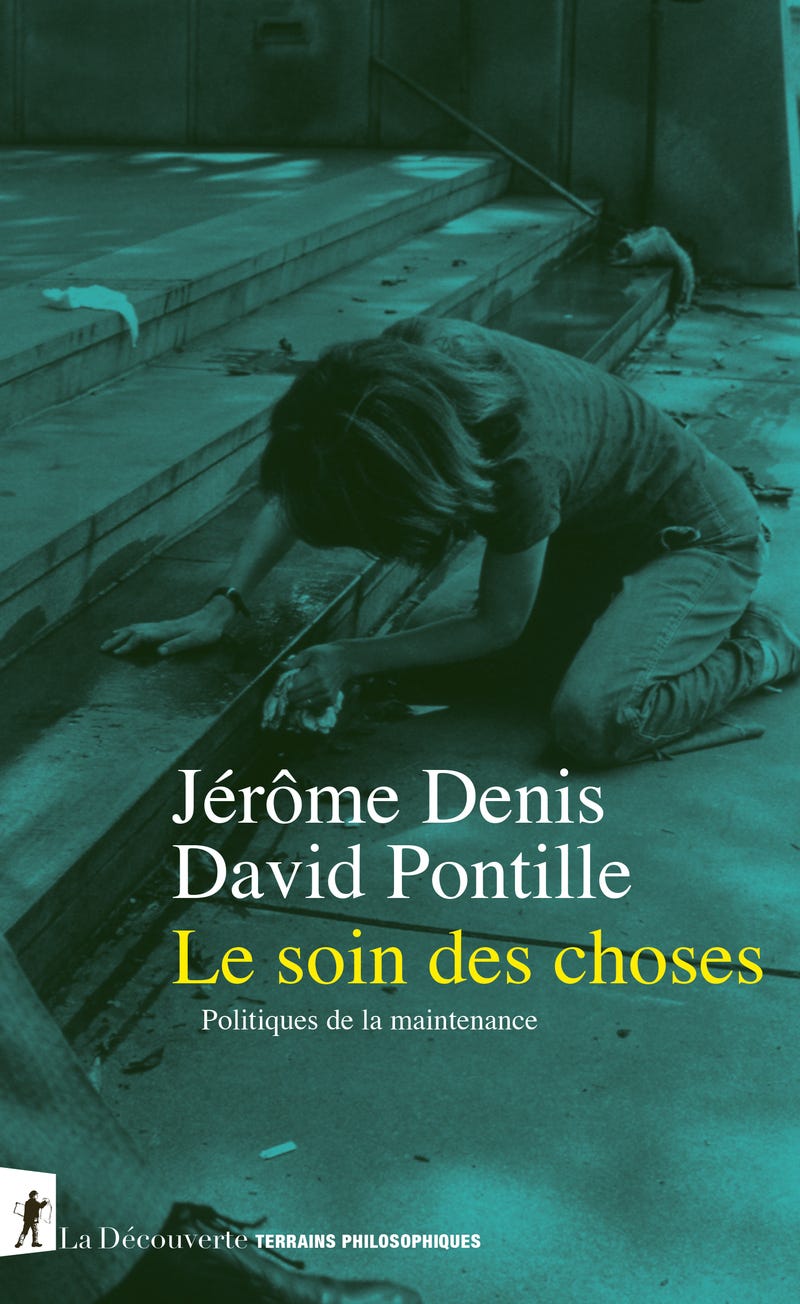
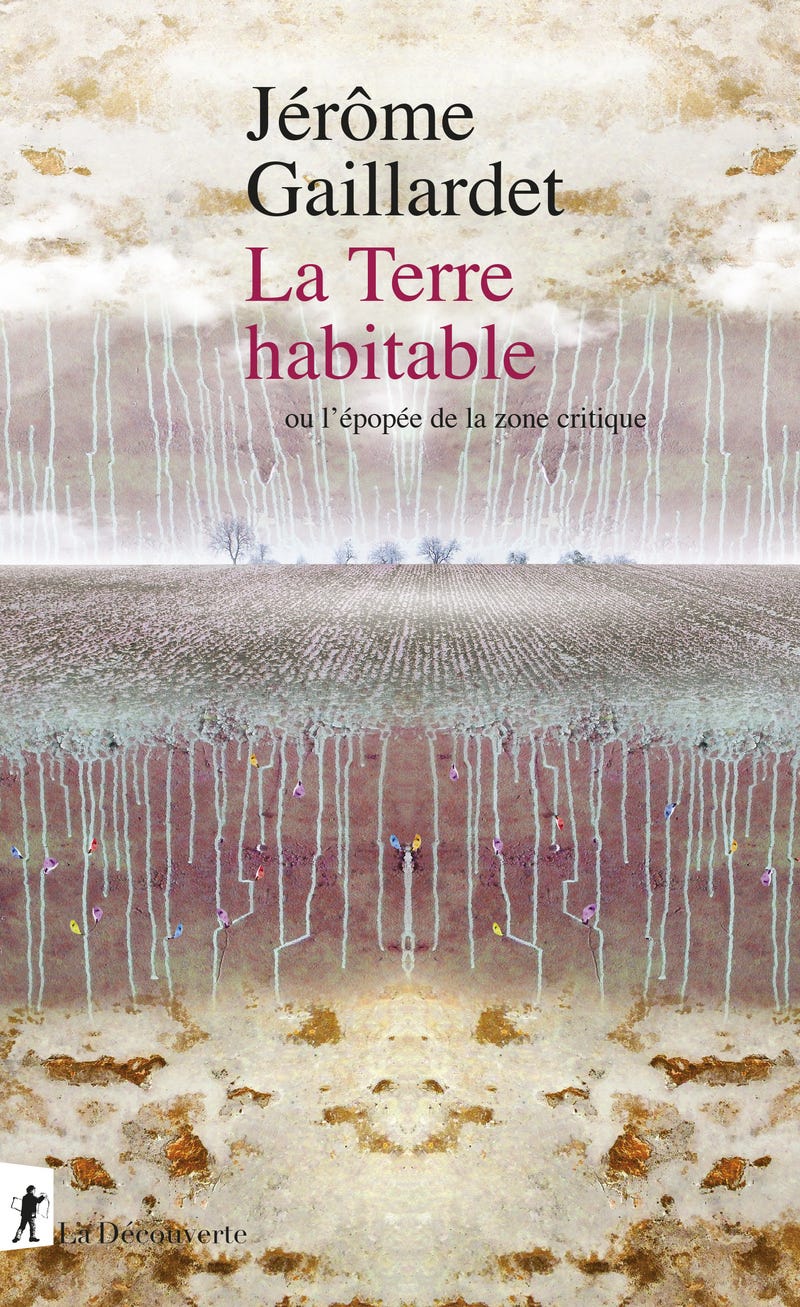
Merci pour toutes ces suggestions. J’ajouterais :
- « Fin du monde et petits fours »
- « Moins! La décroissance est une philosophie »
-« Le chaos qui vient »
- « Agrophilosophie »
que vous traitez peut-être par ailleurs dans 3degrés
Merci pour cette liste, ça va m'occuper un bon bout de temps !
Je viens de terminer le déluge, en effet, certains passages sont vraiment éprouvants et m'ont fait quelques passages (sans jeu de mot ^^) à vide !