#33 : Réflexions sur l'extractivisme
« Froncement de sourcils. Extra-quoi ? Le terme extractivisme déroute. Il manque d’élégance, exige un effort de prononciation. On ne voit pas non plus toujours, d’emblée, à quoi pourrait servir ce nouvel « isme » ». Capitalisme, productivisme, consumérisme et tant d’autres : « autant de notions dont on pourrait croire qu’elles suffisent à embrasser toutes les dimensions d’un ordre économique et social ».
Voilà comment s’ouvre l’enquête de la journaliste Anna Bednik intitulée « Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature : logiques, conséquences, résistances » (éditions Le passager clandestin). Paru en 2016 et réédité en 2019, ce livre montre justement en quoi cette notion mérite d’être décrite et analysée spécifiquement.
Dans ce numéro, je vous propose un tour d’horizon des enseignements que j’ai tirés de cette lecture, que je complète par d’autres analyses dans la dernière partie. Au sommaire :
—> Partie 1 : Planter le décor
De quoi parle-t-on ? Sur quoi portent les critiques contre l’extractivisme ? Quelle tendance ?
—> Partie 2 : Analyses et (contre-)argumentaires
On s’attaquera ici aux justifications habituelles de l’extractivisme (discours développementistes ; calculs coûts / bénéfices ; mines dites « modernes » et « vertes »…). On montrera le problème des raisonnements par la pénurie. On évoquera les limites des recours en justice. Et on expliquera pourquoi faire du climat la priorité absolue peut être un problème.
—> Partie 3 : Que peut-on souhaiter ?
Pour conclure, on citera trois analyses, allant notamment à l’encontre des idées du très médiatique Guillaume Pitron (auteur d’un livre et d’un documentaire récent sur « La face cachée des énergies vertes »).
Partie 1 : Planter le décor
***
De quoi parle-t-on ?
• L’extractivisme renvoie à « l’intensification de l’exploitation massive de la nature, sous toutes ses formes ». Le terme « caractérise aujourd’hui un stade superlatif, obsessionnel, addictif, voire idéologique, de l’activité d’extraction », écrit Anna Bednik.
• En faisant de l’extractivisme le « nom commun des multiples facettes de l’entreprise de prédation et de destruction » à l’œuvre partout sur la planète, l’auteure situe l’extractivisme bien au-delà de l’image que l’on peut s’en faire à première vue (« l’extraction proprement dite des hydrocarbures et des minerais »).
• Elle y inclut « toutes les formes de prélèvements sur la nature » : agriculture industrielle et monocultures forestières « qui dépouillent les sols de leurs nutriments, les exposent à l’érosion et les détruisent » ; pêche intensive « qui vide les océans » ; grands barrages hydroélectriques « qui privent d’eau ou au contraire inondent des terres fertiles et anéantissent la biodiversité » ; industrie des boissons « qui pille les nappes phréatiques et accapare les sources d’eau » ; etc.
***
Sur quoi portent les critiques de l’extractivisme ?
Celles-ci ne portent pas exactement sur les mêmes aspects selon les régions et les modèles :
• En Amérique latine et plus globalement dans les pays du Sud, elle « vise l’injustice d’un modèle économique qui, en enfermant un pays dans une étroite dépendance vis-à-vis de ses « exportations de la nature », détruit les territoires », humainement, écologiquement mais aussi économiquement.
Sur le plan économique en particulier, Anna Bednik dénonce « l’obstination des gouvernements de tous bords politiques en Amérique latine à tirer le plus grand profit possible des « avantages comparatifs » de leurs pays sur le marché mondial, c’est-à-dire à développer les activités extractives pour accroître leurs exportations. L’intensification de ces activités n’a fait que renforcer la spécialisation « primo-exportatrice » des économies régionales ».
Selon elle, ce modèle, en « soumettant durablement les territoires et les populations aux vicissitudes du marché des matières premières », ne fait que « vider la région de ses richesses » dans le seul but de continuer à toucher « une rente éphémère », totalement tributaire du niveau des cours mondiaux.
• Dans les pays les plus développés, la critique de l’extractivisme « dénonce plus généralement les risques sanitaires et environnementaux qu’impliquent les projets d’extraction imposés. Ce qui est refusé, c’est la logique des « zones de sacrifice » qui consiste à accepter qu’un territoire puisse être dévasté pour obtenir des matières premières ou des vecteurs d’énergie ».
• L’auteure évoque plusieurs exemples en France, comme en Creuse, sur un site d’ « anciennes mines d’or, où 550 000 tonnes de résidus arséniés et cyanurés dorment sous une simple bâche », ou bien l’ancienne mine de Rouez dans la Sarthe, « où Elf puis Total ont extrait deux tonnes d’or et sept tonnes d’argent entre 1989 et 1997 » : sur place « trône aujourd’hui un monticule d’environ 300 000 mètres cubes de terres stériles, à l’origine d’un drainage acide alarmant. Prouvé grâce à la mobilisation d’une association locale et confirmé par la direction régionale de l’environnement, ce constat a obligé le préfet de la Sarthe à mettre Total en demeure de procéder à la remise du site aux normes environnementales. Mais la montagne de déchets ne sera sans doute jamais déplacée ni traitée, car le danger serait trop grand. Pour le moment, Total s’est contenté de clôturer le site. »
***
Pas de productivisme sans extractivisme : les deux vont de pair
Anna Bednik écrit explicitement qu’il n’y a pas de productivisme sans extractivisme et sans « asservissement des territoires pour obtenir ces matières ».
Elle met en lumière « le soubassement matériel de l’ensemble du système industriel, productiviste et consumériste mondial » et démontre bien ainsi que la dématérialisation est un mythe, de même que le supposé découplage entre la croissance économique et la croissance des ressources consommées (cf le numéro dédié). « Notre société de la « connaissance et de l’information » est bien loin de se nourrir seulement de matière grise ».
« En continuant à croître, cette économie ne peut que continuer à aggraver les destructions produites pour obtenir cette énergie et ses matières, quand bien même, dans le sillage du « développement durable », la multiplication des oxymores (croissance verte, green new deal…) s’emploierait à nous faire croire le contraire » écrit-elle.
***
Quelle tendance ?
• Anna Bednik montre qu’« en termes « nets » et « absolus », l’économie mondiale consomme non seulement de plus en plus de « ressources naturelles » et notamment minérales, mais elle exige aussi une quantité toujours plus grande de « ressources » différentes ».
Elle rappelle qu’en dépit des gains tant vantés en « efficacité matérielle et énergétique », ces améliorations, en pratique, « ne font pas baisser la consommation globale des matières ».
• L’exemple des métaux est particulièrement parlant. Ces 25 dernières années leur consommation a tout simplement…doublé. Aujourd’hui, « on s’apprête à extraire de la croûte terrestre plus de métaux en une génération que pendant toute l’histoire de l’humanité », citant ici l’ingénieur Philippe Bihouix.
En réalité, « il n’y a pratiquement aucun métal dont la consommation ait baissé », à l’exception du plomb. Par ailleurs le nombre de métaux différents utilisés n’a cessé d’augmenter : « nous sommes passés de l’utilisation d’une vingtaine de « grands métaux » il y a 30 ans à plus de soixante aujourd’hui ».
—> Partie 2 : Analyses et (contre-)argumentaires
***
Le problème des discours développementistes
Anna Bednik dénonce « la récurrence de l’alibi humanitaire pour dissimuler les intérêts privés ».
• Entre autres exemples, elle cite le cas de barrages hydro-électriques au Brésil :
Leurs impacts sont nombreux sur les écosystèmes (« déforestation, émissions de méthane, disparition des poissons, bouleversements des fleuves… ») et sur les habitants (plus d’1 million de personnes déplacées jusqu’en 2008)
…or en retour l’énergie issue de ces barrages ne profite même pas principalement aux habitants : les grands industriels accaparent 30% de l’électricité produite et la payent au prix proche du coût de revient (3 centimes de real le kWh) tandis que la population se voit appliquer l’un des plus hauts tarifs de l’électricité au monde (jusqu’à 45 centimes).
• « De façon générale, si l’exploitation massive de la nature permet peut-être d’assurer le confort de certains, ses conséquences compromettent très sérieusement la subsistance de beaucoup d’autres » écrit Anna Bednik.
« Critiquer l’extractivisme dans les pays du Sud, c’est dénoncer le discours développementiste qui a servi et continue à servir aux pouvoirs en place à justifier des projets destructeurs ».
Elle renvoie dos à dos « les gouvernements dits progressistes », qui « misent sur les politiques sociales que la rente extractive doit permettre de financer », et les néolibéraux, qui tablent sur des retombées économiques positives. « Les uns comme les autres imposent aux riverains des sites d’extraction d’incalculables sacrifices, qu’ils présentent comme « un mal nécessaire » devant conduire au « développement » ».
• En réalité, alors que l’extractivisme est décrit « comme une étape, une phase transitoire », ce modèle s’inscrit « dans la durée ». « Présenté comme dicté par une conjoncture - favorable - spécifique, il apparaît en réalité comme une constante historique ».
In fine, affirmer que « l’extractivisme amène le développement » revient à « considérer que les pollutions, les désastres sanitaires, la déstructuration du tissu social et l’uniformisation culturelle ont un rapport avec la notion d’avancée sociale ».
***
Derrière l’argument de la création d’emplois locaux…
Exploiter les richesses du sous-sol permet-il vraiment de créer des emplois locaux, comme les industriels le défendent souvent dans les pays développés ?
• En France, des opposants à l’exploitation du gaz et pétrole de schiste dans le Bassin parisien sont allés vérifier sur place cette promesse. « Sur certains puits exploratoires, il y avait bien un poste pourvu localement, celui du gardien. Le reste des équipes intervenant en phase de forage était composé de professionnels venus d’ailleurs : une vingtaine de foreurs (employés nomades de la société de forage Cofor), deux ou trois Hollandais de Baker Hughes (carottage) et un employé de l’exploitant pour diriger les travaux (la société américaine Hess Oil, dans le cas de notre exemple). En phase d’exploitation, il n’y a plus besoin ni de foreurs, ni de gardiens : 28 emplois suffisent pour surveiller les 100 puits ».
Selon l’auteure, cet exemple se vérifie aussi souvent ailleurs en raison de la « technicisation des activités extractives » : « les techniciens - main d’œuvre qualifiée et expérimentée dans des domaines de plus en plus pointus - viennent de loin, laissant aux locaux quelques emplois subalternes ».
• Pire, ce phénomène s’amplifie avec la mécanisation grandissante. « Au Chili par exemple, grand pays minier et premier producteur mondial de cuivre, l’impressionnante croissance des volumes de minerais extraits entre 1990 et 2004 (+45% pour l’or, +107% pour l’argent, +240% pour le cuivre) s’est accompagnée d’une chute de plus de 30% du nombre d’emplois dans le secteur ».
***
Le problème des calculs coûts / bénéfices
Cela étant, Anna Bednik estime que « le fond du problème n’est pas comptable : quand bien même les industries extractives créeraient des emplois, cela ne rendrait pas pour autant acceptables les risques qu’elles font courir au milieu, à la santé, à la qualité de vie, à la beauté des paysages, à tout ce qu’on ne saura pas reconstruire. (…) Dit autrement, en reprenant les paroles d’une chanson devenue un classique du répertoire des anti-mines : « La vie est un trésor, et elle vaut plus que l’or » ».
« Le trait commun des projets dénoncés comme extractivistes est de produire des ravages écologiques et humains inacceptables, quels que soient les bénéfices escomptés. L’opposition à l’extractivisme n’a pas à rechercher de justifications en termes de calcul coûts/bénéfices. »
Et Anna Bednik d’insister : « Ce système continuerait à provoquer des ravages même s’il changeait de carburant. S’il est à combattre, ce n’est pas parce qu’il ne serait pas « viable » ou parce qu’il serait « incertain » pour notre confort et notre sécurité. C’est parce qu’il est inacceptable et révoltant en soi. Les destructions qu’il impose ne peuvent pas être négociées ou gérées en bon père de famille ».
***
Le problème des raisonnements par la pénurie
• Bien souvent, c’est « la peur du manque » (chocs pétroliers, pics, épuisement des réserves…) qui « amène les matières premières sur le devant de la scène médiatique et politique ». Pourtant, « même si le « pic de tout » approche, il y aura encore de longues pentes à descendre avant d’arriver au niveau zéro ».
Elle incite donc à se poser la question : « avant que la dernière goutte de pétrole, le dernier gramme d’or, la dernière tonne de cuivre soient extraits des sous-sols, que le dernier hectare de terre arable soit devenue stérile, combien de vies seront détruites, de territoires dévastés ? ».
• Cette question est d’autant plus importante que « les impacts sociaux et environnementaux de l’extraction s’aggravent à mesure que la qualité et la disponibilité des « ressources » diminuent, forçant à recourir à des technologies plus intrusives et plus polluantes ».
Citant deux chercheuses spécialisées, Marta Conde et Mariana Walter, elle écrit finalement : « la véritable question que nous devons nous poser aujourd’hui n’est plus de savoir s’il reste des ressources disponibles, mais plutôt quels seront les coûts sociaux et environnementaux si leur extraction se poursuit ».
• Quant à l’idée selon laquelle les ressources exploitées seraient indispensables au « progrès », et qu’il n’existerait aucune alternative à leur exploitation massive, l’auteure rappelle que « si l’homme a bien « toujours puisé l’indispensable dans la nature », comme le défendent les extractivistes, ces derniers temps, il a tout de même considérablement accru son appétit et ses besoins ! Au cours du dernier siècle, la croissance de l’extraction de certaines ressources (les minerais métalliques et industriels, par exemple) a été presque 7 fois plus importante que la croissance démographique ».
***
Le problème de faire du climat la priorité absolue
En citant le politologue Frédéric Dufoing, elle écrit que les discours officiels et médiatiques font subir à la « question environnementale une sorte de raffinage qui la réduit à quelques enjeux opportuns, expertisables et spectaculaires (le CO2, la couche d’ozone…) et à une séparation, une isolation des autres enjeux de société ».
En particulier, « l’urgence climatique offre un formidable alibi pour imposer de nouveaux impératifs » extractivistes.
« Quelle que soit la « solution » envisagée par les gestionnaires attitrés de la « crise » climatique, l’extractivisme est promis à un brillant avenir. Sa décélération ne s’inscrit pas dans les priorités des décideurs. Le développement industriel des sources d’énergie « bas carbone » ne signera pas non plus sa fin, et les dernières trouvailles techniques visant à « réparer le climat » [géoingénierie] exigent, elles aussi, l’extraction de grandes quantités de matières ».
Dans ce contexte, elle appelle les mouvements climat à « prendre au sérieux l’anti-extractivisme, en ne mettant pas les émissions de gaz à effet de serre au-dessus de toutes les autres formes de destruction de la nature et de la vie. Certes, nombre de militants « climatiques » s’opposent aux « fausses solutions » techno-marchandes et notamment à la manipulation du climat. Mais ils n’en restent pas moins marqués par l’impératif prioritaire de limitation des émissions carbone, devenu le principal critère d’évaluation du caractère « écologique » d’une technologie ou d’une pratique ».
Dès lors, pour faire évoluer les imaginaires, elle invite à ne pas oublier, dans le « caléidoscope des images-chocs des catastrophes concrètes déjà en cours », à côté de « l’ours blanc coincé sur la banquise en train de fondre » et de « la détresse des réfugiés climatiques fuyant les atolls océaniens », « le désespoir des milliers de personnes que l’exploitation du pétrole tue à petit feu » ou celui des « indigènes du nord-ouest argentin contraints d’abandonner leurs lieux de vie dans les déserts de sel convoités pour leur lithium, essentiel aux batteries de nos voitures dites « propres ».
***
Le problème des recours en justice
D’après l’enquête d’Anna Bednik, en Amérique Latine « les batailles juridiques, souvent longues et coûteuses, difficiles à mener sans appuis extérieurs, se révèlent le plus souvent décevantes. Même si certains combats ont pu retarder la mise en œuvre d’un projet, faire évoluer le droit, créer une jurisprudence utile à d’autres, force est de constater que la protection des investissements passe la plupart du temps avant celle des populations locales. Souvent, les dommages ne sont reconnus que lorsqu’ils sont devenus irrémédiables ; à eux seuls, les verdicts de la justice ne font pas toujours le poids face aux intérêts économiques ».
« De façon plus générale, il y a un important décalage entre les textes de loi ou les verdicts rendus, et leur application effective. Même certains hommes de loi ne se font plus d’illusions. Ainsi, pour le procureur uruguayen Enrique Viana, surnommé « le procureur vert » et connu pour ses prises de position contre les industries extractives, le droit environnemental dans son pays est « un droit théâtral », presque jamais appliqué dans les faits ».
***
Sur les difficultés des activistes à résister
L’auteure raconte certaines méthodes employées par les entreprises d’Amérique Latine pour faire taire les opposants. Si les tentatives de corruption directe (sur les autorités ou sur les opposants) sont monnaies courante, les techniques sont parfois plus retorses.
Ainsi, l’une des stratégies évoquées « consiste à fragmenter socialement » : les entreprises commencent à « offrir du travail, proposer des améliorations dans les écoles, etc. », ce qui permet de générer des tensions à l’intérieur des familles et des groupes d’amis, et in fine de mieux diviser autour des projets d’extraction. « La fragmentation sociale est une pratique systématique » relate la journaliste.
Autre méthode citée : « créer une activité économique fantôme, pour éviter ainsi d’être accusé de corruption. En Intag (Equateur), l’entreprise canadienne Ascendant Copper Corporation, la 2e compagnie minière à avoir voulu s’installer dans la zone, s’était ainsi découvert une passion pour l’agriculture biologique, offrant aux paysans un travail dans sa « ferme pilote ». Les témoins rapportent que la charge de travail était quasi inexistante, alors que les salaires avaient de quoi convaincre les hésitants des bonnes intentions de l’entreprise à leur égard ».
***
A propos des mines dites « modernes » et « vertes »
« Les « technologies de pointe » sont une constante du discours publicitaire des compagnies minières et plus largement extractives. Celles-ci se donnent de plus en plus souvent pour « vertes » ou « responsables » » écrit Anna Bednik.
Elle cite l’exemple de la mine de Yanacocha, au Pérou, l’une des plus grandes mines d’or au monde : déjà en 1993, lorsque ses travaux ont débuté, ses promoteurs la vantaient comme la première « mine écologique » du pays. « 19 ans plus tard, le résultat est sans appel : plusieurs lacs asséchés, une consommation d’eau exubérante, le tarissement des rivières, de très nombreux cas de pollution aux substances toxiques (notamment au cyanure), des maladies professionnelles liées au mercure, etc. »
De quoi calmer les ardeurs ? Même pas : « cela n’empêchait pas l’entreprise, en 2012, de faire distribuer dans la rue par des enfants payés 2,7 centimes d’euro sa propagande pour une nouvelle mine « moderne », celle de Conga ».
Partie 3 : Que peut-on souhaiter ?
Il ne s’agit pas ici de dire « ce qui serait souhaitable » en soi (la chose étant très subjective), mais de présenter différents points de vue de spécialistes. Libre à chacun de partager ou non leurs visions engagées ; a minima, cependant, elles me semblent utiles à connaître.
***
1- D’abord, (faire) prendre conscience. Pour Stephan Lessenich, auteur de l’essai « À côté de nous le déluge. La société d'externalisation et son prix » paru en 2019 (commenté ici par Loïc Giaccone), « le mode de vie des sociétés « surdéveloppées » repose sur le pouvoir de l’ignorance, sur un habitus collectif : le pouvoir non seulement de ne pas avoir à rendre compte des conséquences de ses agissements, mais aussi de ne même pas devoir prendre connaissance de celles-ci ».
Prendre connaissance de quoi, exactement ? Que « nous vivons aux dépens d’autrui, et finalement aux dépens de leur vie », estime-t-il en citant notamment les écarts d’espérances de vie. « Peu importe ce que le libéralisme économique peut bien nous raconter et raconter aux autres : la productivité n’est pas un miracle, le progrès n’est pas universel, les perspectives de vie réduites dans les périphéries du capitalisme d’abondance ne sont pas le fruit du hasard. La productivité surprenante et la croissance tout aussi surprenante de l’économie d’ici reposent essentiellement sur l’exploitation systématique des ressources matérielles et du travail physique de la Nature et de l’Homme - ailleurs dans le monde ».
Stephan Lessenich ajoute, en guise d’illustration : « les centres de prospérité se ferment au monde extérieur sur lequel ils peuvent compter pour assurer leur mode de vie. (…) Le fossé en matière de liberté de circulation qui favorise les pays du Nord en est un exemple frappant : collectivement, la moitié du monde voyage dans l’autre, mais ne lui donne qu’un accès très sélectif à son propre espace économique et social. (…) Ce qui est possible pour les uns est refusé aux autres ».
Selon son analyse, « les dividendes de l’abondance qui découlent de cette structure inégalitaire depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, reviennent en grande partie aux sociétés « développées », c’est-à-dire nous, et cimentent encore davantage les inégalités sociales mondiales. Le progrès se réalise ainsi sur le dos de ceux qui rendent possible notre avancée » - ceci afin de nous permettre de« maintenir nos modes de vie, nos opportunités, nos habitudes de consommation ».
Au passage, on voit bien ici en quoi les luttes extractivistes et climatiques vont de pair : les deux impliquent de transformer profondément nos modes de vie, de production, de consommation.
***
2. Refuser pour autant de rentrer dans la logique défendue (notamment) par Guillaume Pitron (auteur du récent documentaire diffusé par Arte « La face cachée des énergies vertes », et du livre « La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique »).
Celui-ci soutient l’idée de rouvrir les mines en France, pour 3 raisons : une raison stratégique (regagner en indépendance), une raison écologique (en ouvrant des « mines responsables »), et une raison éthique (sortir de l’hypocrisie ou de l’aveuglement sur l’extractivisme, en assumant à domicile l’impact de notre mode de vie).
Mais pour Mathieu Brier et Naïké Desquesnes, auteurs du livre « Mauvaises mines », cette idée n’est pas souhaitable, comme ils l’expliquaient en 2019 dans un numéro spécial de la revue « Ecologie & Politique » consacré à l’extractivisme :
« On pense qu’il faut réussir à tenir deux fronts : le refus de l’exploitation à l’étranger et le refus en France. La clé pour atteindre cette ambition, c’est la remise en cause de la croissance. Ce que Guillaume Pitron ne fait pas. Nous, on pose notre propos à l’intérieur d’une critique radicale de la surproduction, dans laquelle on met aussi les énergies vertes dont il parle également. »
En réalité, « ouvrir une mine en France ne va permettre d’en fermer aucune, nulle part. Les éventuelles mines françaises ne feraient que s’ajouter à un marché mondial ».
Par ailleurs, « le risque de la proposition de Guillaume Pitron, et c’est ce qui s’est passé, c’est que son argumentaire soit repris par les miniers : « il faut ouvrir des mines ici parce que c’est notre responsabilité vis-à-vis du reste du monde ». (…) En Guyane, il y a eu un débat à la télé où un minier l’a cité. C’est limite s’il ne brandissait pas le livre de Guillaume Pitron qui pourtant est rempli de descriptions des horreurs de l’industrie minière. »
« C’est tout de même paradoxal parce qu’on arrive à ce que l’ouvrage de Guillaume Pitron puisse être utilisé publiquement par les miniers en disant : « Mais regardez, vous êtes tous des hypocrites, c’est notre responsabilité. » Alors que si jamais la mine se faisait en Guyane, elle rapporterait de l’argent à une seule personne qui est dans les vingt ou trente plus grosses fortunes mondiales, un oligarque russe qui possède déjà je ne sais combien de mégamines à travers le monde ».
***
3- Nous fixer nous-mêmes des limites. Pour le chercheur Stefan C. Aykut interrogé par le média AOC, qui s’exprime ici sur la question climatique (mais dont la réflexion est extrapolable au-delà), « il faut accepter de nous fixer nous-même des contraintes, des limites autres que celles fixées par l’état des ressources. Or ces questions ne sont jamais abordées par la gouvernance globale. [Aujourd’hui] on ne parle pas de limites, on ne parle pas de ressources fossiles, on ne parle même pas d’énergie de manière explicite : on parle d’émissions. C’est l’ancien paradigme qui prime encore, des politiques en fin des tuyaux pour réguler les émissions d’azote, de soufre, de CO2… ».
Or il estime justement que « la question climatique nécessite (…) une approche en amont, qui ne régule pas seulement en fin de tuyaux, mais qui régule ce qui entre dans le moteur et le moteur lui-même ».
Aujourd’hui encore, pourtant, « cette question de la limitation de l’extraction des énergies fossiles qui font marcher nos économies reste largement impensée ». Il souligne ainsi que « l’instrument fétiche de toutes ces discussions depuis des années, c’est la taxe carbone, l’idée de réguler les émissions par une taxe ou par un marché du carbone comme on le fait en Europe. (…) C’est mieux que rien. Mais cela ne règle en rien la question du commerce des ressources fossiles, de leur exploitation. Or, il faudrait vraiment trouver une façon de parler de la fin de l’exploitation des ressources fossiles. Ce sont des questions qui sont mises sur l’agenda par les mouvements activistes contre l’extractivisme, mais politiquement il n’y a que des coalitions très précaires autour de ces questions. Il faut en faire un enjeu beaucoup plus politique. »
***
Pour clore ce numéro, redonnons la parole à Anna Bednik : « bien des choses seraient techniquement possibles si on changeait d’objectifs et d’imaginaire »…et concluons avec ce bel extrait de textes de luttes, qu’elle cite dans son livre :
« Nous habitons ici et ça n’est pas peu dire. Habiter n’est pas loger. (…) C’est un entrelacement de liens. C’est appartenir aux lieux autant qu’ils nous appartiennent. C’est ne pas être indifférent aux choses qui nous entourent, c’est être attaché : aux gens, aux ambiances, aux champs, aux haies, aux bois, aux maisons. À telle plante qui repousse au même endroit, à telle bête qu’on prend l’habitude de voir là. C’est être en prise, en puissance sur nos espaces… Habiter ici, c’est ne plus pouvoir imaginer comment tout ça pourrait disparaître : parce que ça, c’est ce qui fait nos vies ».
C’était le 33e numéro de Nourritures terrestres, la newsletter sur les enjeux de l’écologie (lien pour la recevoir). Tous les numéros précédents sont à retrouver ici.
Pour soutenir mon travail, rdv sur ma page Tipeee : merci par avance !

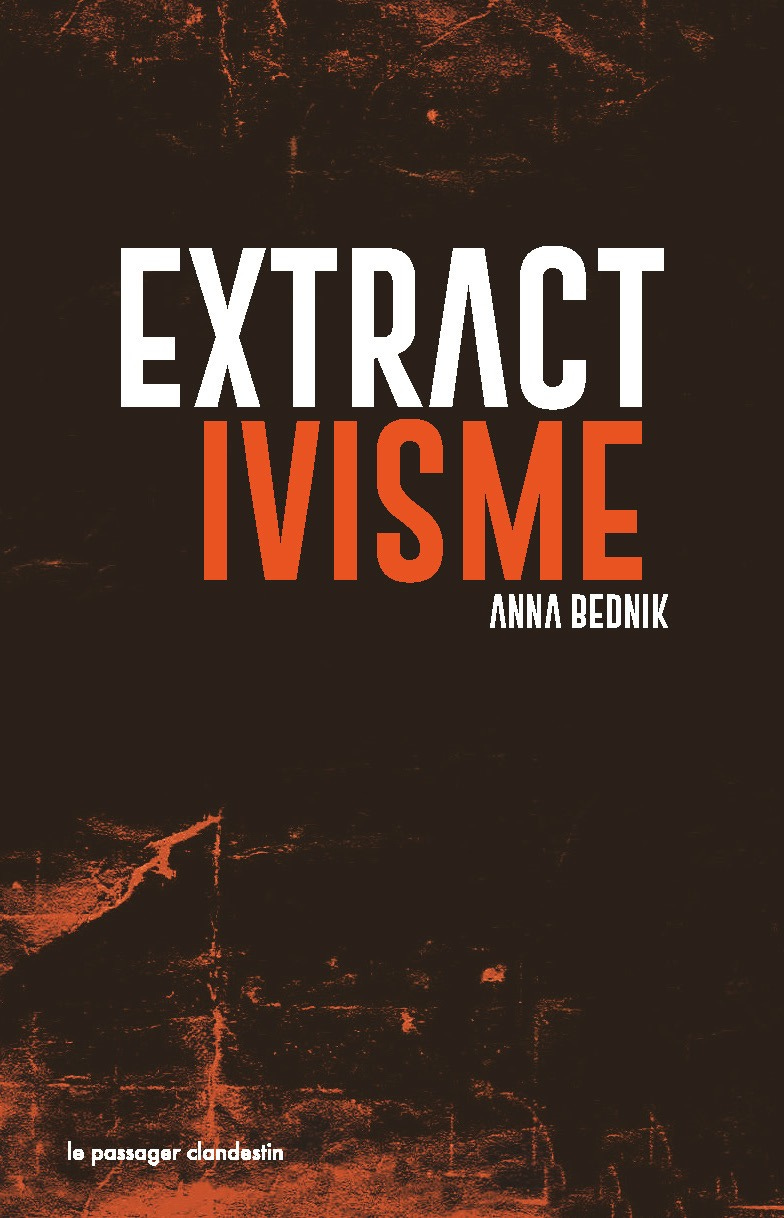

Bien que j’apprécie généralement votre travail, dans cet article, les arguments qui contrent ceux de Guillaume Pitron me semblent inaboutis. L’idée qu’il serait possible de refuser toutes les mines (en France ou ailleurs) démontre d’un incroyable aveuglement face à notre appétit pour ces métaux qui composent l’essentiel des objets sur lesquels peuvent se poser notre regard. De ce PC, à mon agrafeuse, ou ma lampe de bureau. Cet appétit n’a rien à voir avec la croissance, décroissance, a-croissance ou post-croissance de nos économies. Nous consommons des métaux comme nous consommons des aliments, et qu’on le veuille ou non, les métaux sont une partie essentielle de notre « régime » moderne. Espérer que le recyclage seul pourrait nourrir cet appétit est illusoire vu la seconde loi de la thermodynamique et les phénomènes de diffusion qui rendent la récupération de nombreux métaux impraticable. Bien qu’on puisse espérer que cet appétit puisse devenir un jour plus raisonnable, penser que cela mènerait à la fermeture de toutes les mines du monde est illusoire. Surtout devant l’énorme quantité de métal nécessaire à la transition énergétique à base d’énergies renouvelables intermittentes (production/stockage) et la nécessaire électrification de nombreux secteurs. Des mines responsables en France seules ne résoudraient pas le problème mais associées à des barrières douanières imposant la traçabilité des matières premières, comme c’est de plus en plus le cas pour de nombreux métaux, peut-être. Et le fait que la mine guyanaise est possédée par un seul actionnaire privé et non par le peuple est un problème d’un tout autre ordre. Le fait que des miniers « recyclent » les arguments de Guillaume Pitron à leur convenance ne doit pas nous faire perdre de vue la réalité de notre dépendance à ces éléments extraits de la croute terrestre.